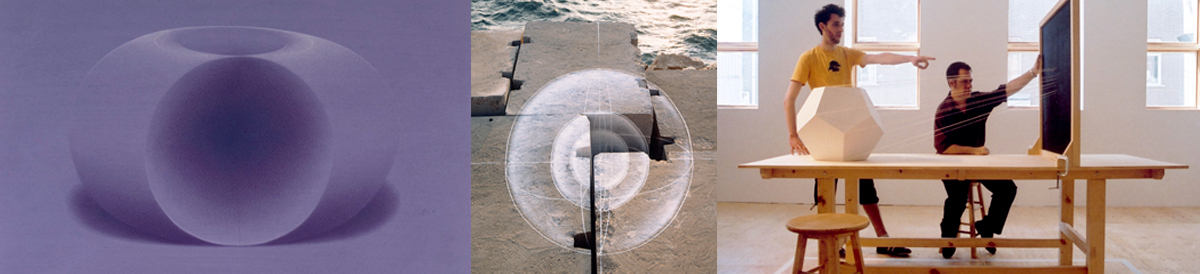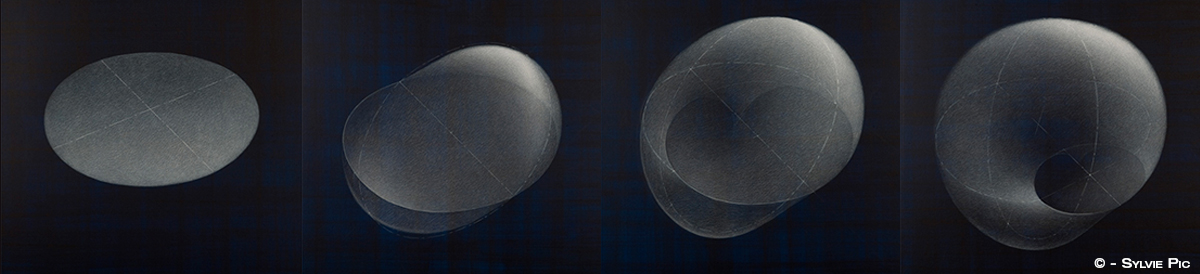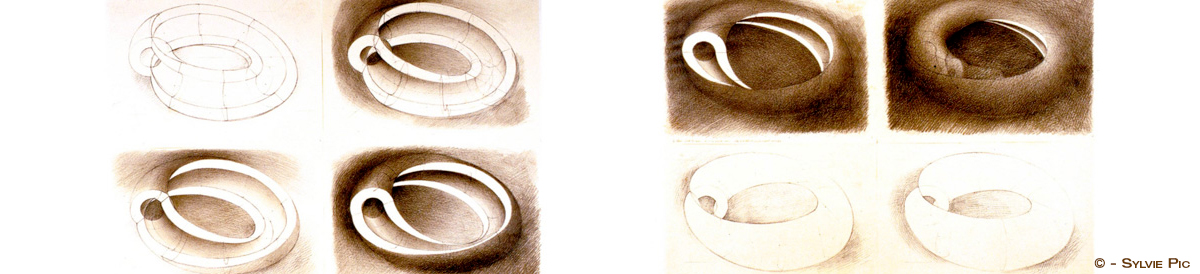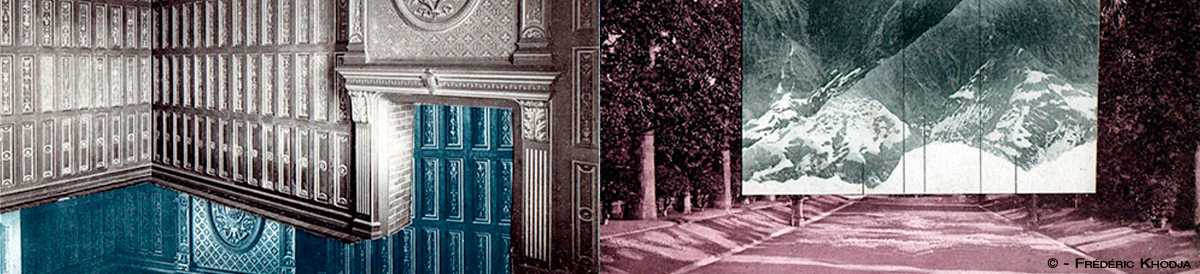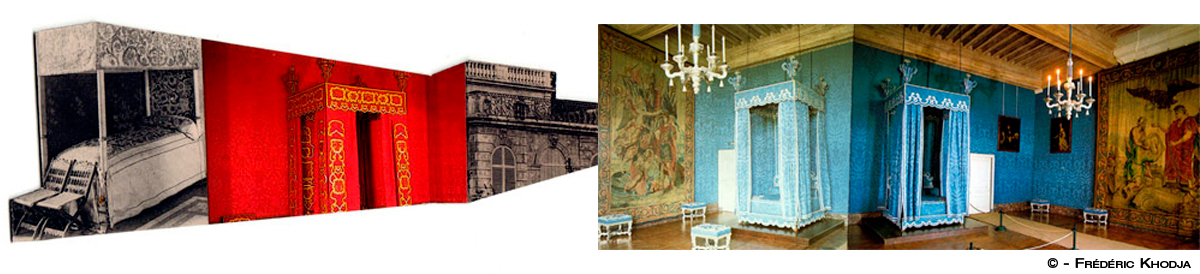BILLET DES MEMBRES
Vive la certification !
Héritières de la première guerre mondiale, les procédures de standardisation n’ont cessé de prendre de l’ampleur dans l’économie comme dans l’administration. Se substituant progressivement à la loi, elles se sont imposées sous la forme de réglementations visant à régir l’ensemble de notre vie sociale et privée, comme autant d’injonctions qui, au nom du bien, de la santé, comme de la sécurité de tous, visent à nous assurer la garantie d’un vivre ensemble harmonieux et satisfaisant... pour peu que tous y obéissent !
Outre que cette utopie, comme toutes les utopies, n’est qu’un leurre, ce recours à la procédure ne relève pas du tout du même semblant que ceux connus précédemment dans l’histoire de l’humanité. Opéré grâce au pas logique fait par Kant, elle consiste à déconnecter toute appréhension, ou mesure, du réel de l’objet. Pure procédure formelle, elle permet d’alléger le gestionnaire ou l’administrateur de toute considération de l’objet (salariés, usagers, pratiques, etc.), pour n’avoir à prendre en compte que la procédure elle-même. Cela génère de fait un clivage radical et irréconciliable entre ceux qui administrent et ceux qui sont quotidiennement au contact avec ce réel. Effet réel d’une logique qui opère bien au-delà de l’intentionnalité des uns et des autres.
Paroxysme de cette pure logique formelle, la certification se veut une garantie de qualité de service dans les institutions sanitaires, sociales, ou de formation, mais justement parce qu’elle opère par clivage d’avec toute prise en compte du réel, c’est ce dont elle est coupée. Ce qui reste dans le noir, puisque la certification est une procédure qui ne vise qu’à vérifier que la procédure a bien été appliquée. Sa transparence est un obscurantisme, puisqu’en fait elle ne fait que se vérifier elle-même.
D’où, malgré l’obligation dans lesquelles ces institutions sont soumises à devoir être certifiés, le plus souvent d’ailleurs par des organismes privés, eux-mêmes certifiés, les multiplications des scandales dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou les organismes de formation, pour ne citer que ceux-là. La multiplication de ces procédures administratives, au mieux prennent beaucoup de temps aux professionnels, mais ne servent à rien, au pire instaurent une référence à une réalité virtuelle qui, en se substituant au réel, impose aux professionnels une standardisation des pratiques propre aux systèmes totalitaires à qui nous devons le modèle que nous nous efforçons d’appliquer.
Il ne fait aucun doute que nous évoluons dans une démocratie libérale qui n’a rien à voir avec une dictature comme dans d’autres pays proches, mais c’est justement parce que cette démocratie libérale a voulu s’affranchir de toute figure d’autorité, qu’elle s’est progressivement précipité dans une logique sans autre référence que de pure forme. Véritables usines à gaz, les certifications n’auraient pas de plus de conséquence que cela si elles n’opéraient pas une vraie torsion de notre rapport au monde. C’est-à-dire de notre rapport au langage. Le coup de force a été, depuis la moitié du XXᵉ siècle, de pousser encore plus avant la déconnexion du formalisme non seulement d’avec l’objet, mais également d’avec l’idée, de se présenter comme sans idéologie, comme pur formalisme logique, devenu alors incontestable puisque sans « sens ». C’est ce que le langage permet, non seulement que le mot soit délesté de la chose, mais encore qu’il soit déconnecté de sa référence signifiante (dénouage complet de la structure du langage). Ainsi les mots de ce vocabulaire de la certification opèrent comme relevant d’une opération de pure forme : la qualité ne veut pas dire la qualité, mais la conformité à la procédure, l’équivalent temps plein ne désigne pas une personne, mais un temps de travail délesté de la personne qui l’exerce, etc. Cela permet de remplacer n’importe quelle procédure par n’importe quelle autre, ou n’importe quelle personne par n’importe quelle autre, sans avoir à s’encombrer du réel des pratiques ou des personnes. Il en est de même lorsqu’il s’agit de remplacer le psychisme humain par le cerveau. Cela a effet immédiat de réduire l’homme à un organe, ce qui n’est pas sans conséquences pratiques, c’est-à-dire éthiques.
Il est à remarquer comme un indicateur, justement dans le fait qu’il reste aveugle, sauf peut-être pour quelque uns, le rapport étroit qu’il y a entre la généralisation des certifications dans les établissements médicaux et/ou sociaux et la fuite massive des professionnels de la santé comme du social.
C'est susceptible de nous indiquer qu’en modifiant ainsi radicalement notre rapport au monde, parce que notre rapport au langage, la certification n’est pas un outil dont on se sert, on lui est asservie. Volontairement même dans bien des cas, puisque lorsque ce n’est pas pour ne pas perdre un agrément vital, c’est le plus souvent pour des raisons mercantiles que les institutions elles-mêmes s’y engagent, avoir une part de marché. Nous sommes libres d’obéir, mais comme fascinés par la logique perverse qui nous est proposée, nous ne résistons pas à cette promesse de jouissance garantie, quitte à nous y perdre. Est-ce étonnant après tout ? N’est-ce pas finalement le rêve de tout névrosé, d’être pervers ? Bien entendu, les pervers y retrouvent d’autant plus leurs billes. Ils y évoluent avec aisance et ont même le vent en poupe comme on dit, mais cette logique sociale embarque tout le monde, quelle que soit sa structure.
Il n’est cependant pas sûr que cette perversion généralisée ait comme effet celui escompté, y compris par ceux qui croient pouvoir la maitriser. Comme l’a très mis en évidence Marcel Czermak, dans le livre d’entretien d’Hélène Heuillet, c’est une perversion qui rend l’autre d’autant plus fou qu’elle ne relève aucunement de la structure subjective de l’un ou de l’autre, qu’elle est donc aveugle pour la plupart d’entre nous. Cela étant dit, comme ce qu’elle produit immanquablement, comme face au pervers, c’est la fuite, c’est sans doute un bon indicateur clinique pour nos institutions !
Comme un mur mure…
Dimanche soir, au cours d’un dîner sur la terrasse d’un petit restaurant au bord de l’eau, au nord du lac d’Annecy, nous conversions avec ma compagne de la grande voie d’escalade que nous venions de gravir le jour même : « L’écume des jours », dans une magnifique falaise qui se situe au sud du plateau des Glières.
Lors de nos échanges, nous parlions de l’importance, dans cette activité d’escalade, du travail de lecture de la voie. Pour les profanes, cela consiste, avant et pendant, à lire les prises le long de la voie, afin d’anticiper et d’articuler les positions et mouvements du corps nécessaires pour donner corps à cette lecture, d’acquérir une fluidité des gestes, de rythmer une chorégraphie, assez analogue à une danse ou un chant.
J’évoquais, au cours de cette discussion, que progressant peu à peu dans cette discipline, j’étais de plus en plus sensible, voire attaché, à ne plus simplement vouloir grimper, mais à lire la voie qui avait été ouverte et équipée par celui qui l’avait initiée, à retrouver le texte, l’enchainement littérale des différentes prises, leur articulation. Lecture indispensable pour me permettre d’enchainer les pas, de savoir où poser mes pieds, mes mains et mes doigts, dans la trace sans marque de cette voie silencieuse que je lis peu à peu, pas sans plaisir d’éprouver un « c’est ça ! », « c’est comme ça! » ; Plaisir presque jubilatoire du lecteur débutant qui déchiffre pour la première fois un texte ou une partition musicale. Précisons, s’il en est besoin, que ce n’est pas toujours le cas, loin de là, mais c’est ce qui fait aussi le précieux de ce déchiffrage lorsqu’il résonne enfin de façon juste et que les pas s’enchainent aisément.
Voie écrite donc par un autre qui l’avait littéralement inventée là où il n’y avait rien qu’une roche brute. Il convient de préciser que les voies d’escalade n’existent que par la lecture d’un qui y a lu, sur ce rocher brut, sur ce réel-là, une combinatoire de prises et de pas, de positions et de mouvements, qui n’existaient pas avant qu’il les ait lus, enchainés et éventuellement équipés (sécurisés pour les prochains). Il en est de même en salle où sur une grande surface lisse un « ouvreur » va lire et fixer des prises, les écrire, pas sans poésie dans cette chorégraphie. On dit qu’une voie est belle, ou pas. O _ - / ( ) : voici quelques unes des lettres possibles dans cet alphabet particulier.
M’est alors apparue l’évidence que la lecture de ce réel, voire du réel, précède son écriture, que l’acte d’invention est celui de la lecture de ce réel comme acte d’écriture. Dans un autre registre, E=MC2 n’est que l’écriture d’un réel qu’Albert Einstein avait d’abord lue dans le réel de la physique, avant de l’écrire pour que d’autres le lisent. Ce n’était pas là écrit d’avance, comme une écriture à découvrir ! Pas non plus comme un « pas encore connu » ! Comme en ce qui concerne les lettres de la formule de la triméthylamine au fond de la gorge d’Irma avant que Freud ne l’ai lue et en ai donné statut d’écriture, de lettres. C’est écrit, parce que quelqu’un a lu ce réel ainsi, l’a déchiffré en tant qu’invention de lecture et élévation au statut d’écriture.
Pour en revenir à l’escalade, ce qui est intéressant, c’est également que cette lecture qui ouvre la voie, puisqu’elle a été lue, puis est devenue écrite, ouvre aussi à différentes lectures possibles. Car si le rocher est un réel immuable, la combinatoire des prises, l’imaginarisation de leur symbolisation, peut être lue et « passée », dit-on dans le jargon des grimpeurs, de façon différente, selon le style de chacun et pas uniquement sa morphologie. Il y a donc toujours plusieurs lectures possibles, de ce qui a été écrit, parce que déjà lu.
Pour le dire autrement, il m’est donc venue cette remarque que ce qui était écrit, n’était écrit que dans l’après coup d’une lecture qui donne son statut d’écriture à ce qui passe ainsi du réel au texte. Dans « Le métier de Zeus » de Jesper Svenbro et John Scheid, il est rappelé qu’un texte dans l’antiquité n’était pas nécessairement matériellement écrit, mais relevait le plus souvent de l’invention d’une combinatoire, d’un tissage, qui se mémorisait et se répétait à l’identique, récit après R.S.I., en tant qu’il forme l’étoffe du texte littéral. C’est ainsi que dans son prélude le texte du « Banquet » de Platon est transmis. C’est un récit, au moins trois fois récités avant. Au moyen âge, il semblerait que les poètes déclamaient leurs oeuvres, leurs poésies, leurs inventions, leurs créations, dans des lectures publiques faisant résonner le texte qui s’y fondait. Ouverture dans le réel d’une combinatoire qui n’existait pas avant qu’elle soit lue et ouvre à d’autres lectures possibles, à d’autres combinatoires de lettres, à d’autres vocalises de la voie ainsi ouverte.
Vous avez sans doute déjà largement entendu comment cette expérience, ce qu’elle m’a inspiré, résonne avec celle de la cure analytique. Dès le premier entretien, il n’est pas rare qu’un analysant puisse dire que c’est la première fois qu’il dit, lit ainsi, le récit de son expérience ; Une lecture nouvelle parfois, une autre lecture possible assez souvent. Plus avant dans la cure, si une analyse a une efficience, n’est-ce pas dans ce qu’elle rend possible une création, une invention, la lecture d’une nouvelle voie, de ce qui n’était pas écrit, mais relevait des aspérités d’un réel à lire. Un « Cela aura été ! » tel que le futur antérieur de la langue française le fait si justement entendre. Pour laisser filer encore un peu la métaphore de l’escalade, car bien entendu il n’y a aucune analogie entre l’escalade et la psychanalyse, sauf des effets du signifiant qui nous dénature, l’issue d’une cure est sans doute pour un sujet la possibilité de « savoir y faire » quand il se retrouve au pied du mur, face au roc de son réel, et qu’il peut savoir, seule promesse de la psychanalyse, y inventer une lecture qui fasse écriture, oriente son existence. En fait, rien de nouveau ni d’original, seulement l’amusement de redécouvrir, si loin de mon cabinet, ce qui est sans doute pour moi encore au travail à l’occasion de cette soirée dominicale.
Sur le littoral de ce magnifique lac d’Annecy, par cette douce soirée d’automne en charmante compagnie, ces quelques remarques littérales que je ne pouvais taire, témoignent ou sont l’effet, allez voir, du texte de « L’écume des jours » sur un psychanalyste finalement jamais très loin du lieu où s’entend : « qu’on dise... ! »
Home sweet hommes !
Home sweet hommes !
Le lundi 18 octobre 2021 le site de France Info diffuse comme actualité le titre suivant :
« Oser le féminisme attaque Miss France aux Prud’hommes ».
C’est quand même une perle d’humour. Volontaire ou pas, on ne peut sérieusement pas soupçonner les journalistes de France Info de ne pas être féministes, mais comment ne pas entendre que ce titre d’actualité résonne comme un lapsus. Il dit autre chose qu’une information juridique. Il fait entendre qu’au-delà de la juste revendication des droits et de la lutte contre des violences, le féminisme relève fondamentalement d’une « attaque » (vocabulaire guerrier s’il en est) contre le féminin, le sexe et le désir.
Ce n’est pas seulement une guerre des sexes, mais plus radicalement une guerre contre le sexe (étymologiquement la section, la coupure). Autrement dit, une guerre contre l’autre devenu insupportable dans sa différence, ses modes de vie, ses désirs. Là très clairement une guerre contre des femmes qui sont autres et d’autant plus insupportables qu’elles revendiquent leur féminité dans leur désir d’être désirables.
Comment ne pas réaliser que ce qui est annoncé comme un progrès de notre culture alimente en même temps une intolérance à l’autre qui est de plus en plus brutale : l’exigence immédiate de l’éradiquer sans autre forme de procès, au nom de s’en croire victime. Ce point aveugle vient sans doute du fait que si comme cela semble résonner dans ce titre, il s’agit bien là d’un « lapsus calami », c’est alors une guerre insu de la part de ceux qui la mènent, puisqu’ils sont persuadés être pleinement légitimes dans leurs combats. De tout temps dans l’histoire, la position de victime a toujours justifié les plus grandes exactions, les pires horreurs. Le bolchévisme et le nazisme n’en sont que de récents exemples (notons que les mots en « ismes » sont souvent de mauvais augure). Cette intolérance à l’autre s’illustre par le fait que ce mouvement récent dans notre histoire qui s’est très rapidement imposé comme une évidente réponse univoque à l’angoissante question du bien et du mâle, n’est aucunement questionnable. Celui qui viendrait ne serait-ce qu’interroger le dogme est automatiquement considéré comme inentendable, jugé et condamné à disparaitre de la scène sociale. Cet aveuglement barbare des défenseurs de la cause devra sans doute, comme cela n’acessé de se répéter dans l’histoire, attendre de rencontrer son réel pour que cela puisseavoir un effet de réveil. Ce n’est pas que ce mouvement n’ait pas déjà produit son lot dedommages, auprès de femmes, d’hommes, comme d’enfants (ce n’est pas sansconséquences quotidiennes dans les familles), mais tant que l’horreur ne passe pas uncertain seuil c’est comme si chacun était aveugle, ne voulait pas savoir ce qu’il produit,en ne supportant pas que quiconque vienne soulever le voile, dévoiler le leurre de ce Moi tellement idéal, tellement bien, tellement juste dans ses convictions.
Mais sans doute ne suis-je pas assez prude homme !
(8 novembre 2021)